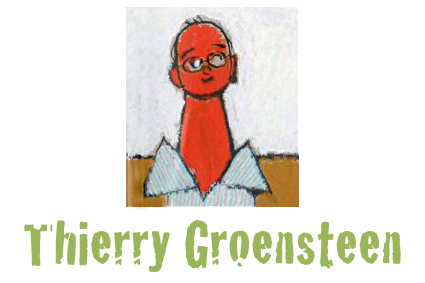J’ai toujours eu pour habitude de nourrir ma réflexion théorique sur la bande dessinée de mes lectures dans les champs les plus divers. Dernièrement, ce n’est pas par un essai relevant de l’esthétique, de l’histoire de l’art ou de la sémiotique que je me suis senti interpellé, mais par un livre du neurologue Lionel Naccache, intitulé Apologie de la discrétion. Comment faire partie du monde ?, publié chez Odile Jacob en 2022.
Discrétion doit s’entendre ici au sens mathématique du terme. En mathématiques, on distingue les ensembles continus et les ensembles discrets (par exemple, celui constitué des nombres entiers). Naccache applique le concept à notre système cognitif : comment percevons-nous le monde, comment notre cerveau traite-t-il les informations qui lui parviennent via nos cinq sens ?
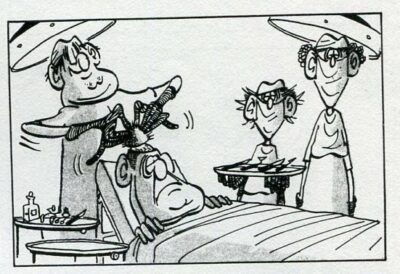
Don Martin, « Brain operation » – © E.C. Publications
Selon lui, nous sommes victimes d’une illusion. « Nous croyons naturellement et par défaut être des créatures continues qui vivent dans un univers continu » (p. 37) quand, en réalité, il s’agit d’une impression trompeuse, car nous ne saisissons que des fragments du monde, particulièrement du monde visuel. Et il est heureux qu’il en soit ainsi car, si la discrétion de notre flux de conscience n’était pas masquée par un effet de continuité, nous verserions dans la schizophrénie (p. 125).
Naccache souligne le fait que les médias auxquels nous sommes exposés présentent souvent un caractère discret, oblitéré par notre représentation mentale subjective. Chacun sait que c’est le cas du cinéma. Quand nous regardons un film, la persistance rétinienne nous permet de convertir une suite d’images arrêtées projetées à la vitesse de 24 par seconde en un flux donnant l’illusion de la continuité, notamment en termes de mouvement. Mais il n’en va pas très différemment quand nous lisons un texte : les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes tendent eux aussi à être perçus, non comme des éléments discrets, mais comme pris dans un flux.
Le neurologue note que cette propriété de discrétion s’étend à l’imagination et au rêve. Il ne mentionne pas la bande dessinée. Or, à la lire, il m’est apparu comme une évidence première que celle-ci tranche avec les autres médias (le roman-photo excepté) en ceci qu’elle ne simule pas un flux continu, mais s’affiche sans ambiguïté comme une collection dénombrable d’éléments discrets, les cases ou vignettes, qui généralement sont chacune fermée, encadrée, isolée par du blanc. Quand nous regardons une page de bande dessinée, nous percevons la totalité et les parties, et notre attention peut se concentrer sur chacune d’entre elles.

Rien là que de banal, il y a beau temps que les théoriciens ont décrit la bande dessinée comme un langage discontinu. Ce qui m’a frappé davantage, ce sont les références que fait Naccache à l’akinétopsie, terme qui désigne le syndrome de la cécité au mouvement. Suite à une atteinte du cortex cérébral, les patients qui en sont atteints font des « arrêts sur image » qui durent plusieurs secondes, pendant lesquelles ils perdent toute conscience visuelle des mouvements dans leur environnement. Entre les images qui leur parviennent consciemment, il y a donc, chaque fois, une ellipse. Et le monde, pour eux, se donne comme tout à la fois immobile et discontinu. Exactement comme une bande dessinée !
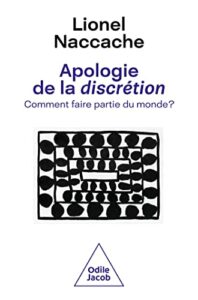 Je lis sur internet que « les personnes touchées par l’akinétopsie voient le monde en photogrammes ». Certes, le monde tel que nous le percevons ne nous apparaît pas comme dessiné. Cependant, de tous les médias, c’est bien la bande dessinée qui se rapproche le plus de l’expérience du monde que vivent ces personnes-là. Tintin (ou Mickey, ou qui vous voudrez) est ici, puis là, et je ne l’ai pas vu se déplacer. Depuis mon plus jeune âge, mes lectures dessinées me font vivre l’accès à la fiction sur le mode de l’akinétopsie. Et je découvre cela aujourd’hui, comme Monsieur Jourdain découvrait, sur le tard, qu’il avait toujours fait de la prose.
Je lis sur internet que « les personnes touchées par l’akinétopsie voient le monde en photogrammes ». Certes, le monde tel que nous le percevons ne nous apparaît pas comme dessiné. Cependant, de tous les médias, c’est bien la bande dessinée qui se rapproche le plus de l’expérience du monde que vivent ces personnes-là. Tintin (ou Mickey, ou qui vous voudrez) est ici, puis là, et je ne l’ai pas vu se déplacer. Depuis mon plus jeune âge, mes lectures dessinées me font vivre l’accès à la fiction sur le mode de l’akinétopsie. Et je découvre cela aujourd’hui, comme Monsieur Jourdain découvrait, sur le tard, qu’il avait toujours fait de la prose.
[ bandeau : Lionel Naccache (photo X) ]