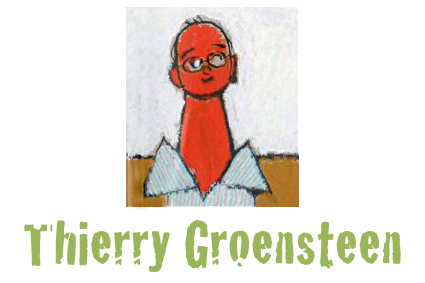On se souvient de la belle adaptation dessinée par Gaétan Nocq du roman de Claudie Hunzinger Les Grands Cerfs, paru en 2019. En 2021, dans une interview à Télérama, Nocq laissait entendre qu’il avait approché la romancière avec l’intention de lui proposer ce projet, et même en ayant déjà quelques planches à lui présenter (https://www.telerama.fr/livre/l-auteur-de-bd-gaetan-nocq-j-ai-toujours-prefere-les-histoires-qui-laissent-un-gout-amer-7007589.php). Cependant, le roman suivant de Mme Hunzinger, intitulé Un chien à ma table, donne une autre version de leur rencontre. Voici comment elle la relate (il faut avoir à l’esprit qu’elle habite une maison complètement isolée dans les montagnes vosgiennes).
« Puis, un soir de neige, de cette incroyable neige de mars, quelqu’un a frappé à la porte (…). Un jeune type. (…) Il avait quelque chose de candide qui faisait honte à notre affolement. Sa soudaine apparition de jeune homme mince. Sa petite barbe bien taillée, sa moustache, quelque chose d’un frêle Errol Flynn. Je l’ai invité à entrer. Il était trempé et tenait une carte IGN trempée. (…) Le jeune type s’appelait Gaétan. Il dessinait des BD. Il était déjà sur le seuil, quand il nous a dit que dessiner était son travail. (…) Tout frigorifié qu’il était, ce garçon n’a pas voulu rester pour la nuit. Non, je vous remercie. J’aime mieux camper. Il lui fallait la neige fondue. Le flottement des choses. Oui, j’aime camper, c’est un truc initiatique. »
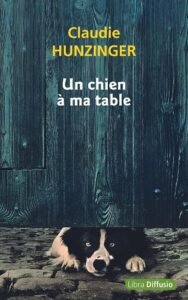
On ne saurait reprocher à une romancière de romancer quelque peu les circonstances de cette première prise de contact. À moins que ? En tout cas, une séquence du beau film documentaire de Vincent Marie La Disparition des lucioles (2024) montre la belle complicité qui s’est nouée ensuite entre Gaétan et Claudie.
*
Un autre montagnard qui vit quasiment en ermite est Jean-Marc Rochette, installé dans la vallée du Vénéon, au cœur du massif des Écrins. Dans La Chair du monde, livre d’entretiens avec Adrien Rivierre paru cette année chez Allary éditions, il exprime une opinion plus que réservée à l’endroit de la bande dessinée.
« … je sais que [mes livres] appartiennent à de la sous-littérature. Soyons lucides, dans la BD nous sommes très loin de Kafka ! Je m’excuse mais entre la meilleure planche de BD et une sculpture de Picasso ou un roman de Tolstoï, il n’y a pas de discussion possible. Devant une planche d’Uderzo, je reconnais le génie du trait et je suis fasciné par sa dextérité, mais si je la mets à côté des Ménines de Vélasquez, pas besoin d’engager le débat… De la même façon, j’admire Crumb mais ce n’est pas Otto Dix ou Kokoschka. J’ai toujours eu conscience des limites de ce médium et, à titre personnel, je ne ressens aucune frustration car je ne cherche pas à hisser la BD à un niveau littéraire qu’elle n’a pas intrinsèquement. » (p. 170)
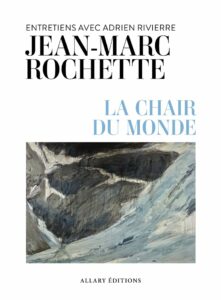
Et encore : « … la peinture ou la littérature se distinguent par leurs capacités à toucher l’essence des choses. (…) Au contraire, la BD repose entièrement sur la narration, mais une narration qui évite les profondeurs de la psyché humaine. » (p. 171)
On pourrait sans doute essayer de lui objecter les œuvres de tel ou tel créateur (Munõz et Sampayo ? Chris Ware ?). Mais je crois que la meilleure réponse à faire est simplement que les médias disent différemment des choses différentes.