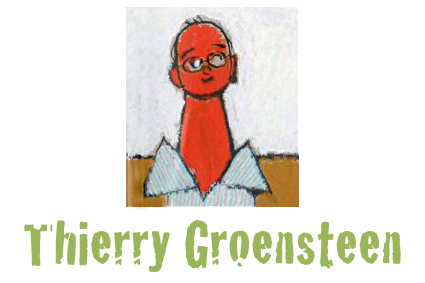On me dira qu’il n’est plus temps de revenir une fois encore sur l’exposition « Bande dessinée 1964-2024 » présentée au Centre Pompidou, plus de six mois après sa fermeture. Mais, dans la mesure où de nouvelles considérations sur les choix qui y avaient présidé se sont récemment exprimées, il me semble qu’il n’est pas abusif de prolonger la discussion. Non seulement c’est une exposition qui a fait date et à laquelle on continuera longtemps de se référer, mais les questions qui vont être soulevées ont une portée plus générale.
Je fais référence ici au compte rendu que signe Sylvain Lesage dans le dernier numéro de European Comic Art (vol. 18, n° 1), la revue d’études en langue anglaise dirigée par Laurence Grove, Anne Magnussen et Ann Miller. S’il reconnaît la richesse et la qualité exceptionnelle de la sélection des œuvres réunies pour l’occasion, en provenance des trois principaux pôles d’expression : l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon, Lesage formule néanmoins plusieurs réserves. Il juge « très classique » la structuration du parcours en une série de salles thématiques, regrettant que les thèmes retenus manquaient d’originalité et ne permettaient pas de nouvelles comparaisons ou perspectives. C’est son avis et je le respecte. J’aurais toutefois aimé savoir quels autres thèmes auraient eu sa préférence. Il est certain qu’au cours de nos réunions de travail, mes trois collègues et moi en avons évoqué de nombreux qui n’ont finalement pas été retenus, soit parce qu’ils ne faisaient pas consensus entre nous, soit parce qu’ils ne permettaient pas véritablement la confrontation entre les trois aires culturelles citées plus haut, ou tout simplement faute de place.
Son grief le plus appuyé est que l’exposition, selon lui, « restait sourde aux récents progrès de la recherche ». À l’appui de cette affirmation, il s’en prend particulièrement au traitement réservé à la question de la couleur dans la salle « Couleur / Noir et blanc ». En effet, les œuvres en couleur que nous avions choisi d’exposer relevaient de la technique de la couleur directe. Elles étaient le fait d’artistes aussi indiscutables que Moebius, Bilal, Loustal, Barbier, Claveloux, Mattotti, Baudoin, Evens et Sfar. Par définition, le choix de la couleur directe ne peut être assumé que par des « auteurs complets » : couleur et dessin sont solidaires et de la même main. Le recours à un collaborateur ou une collaboratrice spécialisé.e, le ou la coloriste, n’est donc pas de mise. Ce que regrette Lesage, c’est que le travail des coloristes n’ait pas été évoqué dans l’exposition.
C’est un universitaire qui s’exprime, et les attendus des chercheurs ne coïncident pas forcément avec ceux des curateurs d’exposition. Leurs agendas non plus. Il est exact que ces dernières années ont permis une réévaluation de la place des coloristes dans le processus de création des bandes dessinées, et la revue en ligne NeuvièmeArt2.0, dont Lesage est co-rédacteur en chef, a récemment accueilli d’assez nombreux (et bienvenus) éclairages sur le sujet, qu’avait déjà largement traité l’exposition « Couleur ! » présentée en 2023 au festival d’Angoulême. Cette réhabilitation participe, du reste, de la trop tardive promotion des femmes dans notre domaine – le métier de coloriste étant plus souvent exercé par des femmes.
Je ne dédaigne nullement le sujet et j’avais accueilli, au cours des années 1980, une enquête pionnière de Sylvain Bouyer à ce propos dans les Cahiers de la bande dessinée. Mais ce qui est légitime dans une revue savante et dans une exposition entièrement dédiée à la couleur n’est pas forcément pertinent, attendu et nécessaire dans une exposition comme celle présentée au Centre Pompidou, où il s’agissait de célébrer l’art de la bande dessinée à travers un éventail de créateurs parmi les plus importants. Elle ne s’adressait pas aux seuls bédéphiles mais à ce que l’on appelait naguère le « grand public cultivé », ne se voulait ni érudite ni didactique (nous n’y expliquions pas le processus de création des bandes dessinées), visant avant tout à la délectation – pour reprendre le mot qui, selon Nicolas Poussin, définissait la fin de l’art.
Lesage cite aussi les pages des Bijoux de la Castafiore que nous avions choisi de présenter, seul exemple de confrontation entre crayonnés, planches encrées et mises en couleur sur « bleu ». Le fait que seul Hergé ait été crédité, sans qu’il soit fait mention de la part prise par son Studio dans la mise en couleur (« probablement réalisée par la chef coloriste Josette Beaujot ») lui semble une faute. Faut-il rappeler qu’Hergé n’a jamais crédité aucun de ses collaborateurs dans ses livres, que les noms de Bob de Moor, Edgar P. Jacobs, Jacques Martin ou de Jacques Van Melkebeke, notamment, n’y sont jamais apparus ? Aurions-nous dû corriger les choix assumés conjointement par l’auteur et de l’éditeur en sortant de notre chapeau un nom de coloriste à propos duquel, du reste, nous n’avons pas de certitude ? En outre, et sans rien enlever à leur talent, les coloristes qui ont travaillé sur Tintin appliquaient les consignes très précises d’Hergé en ce qui concerne la technique en aplat, le choix d’une gamme de tons pastel, le bannissement de tout effet de lumière ou de matière, et c’est donc bien lui, ultimement, qui pouvait endosser la paternité du système chromatique prévalant dans ses œuvres.
Les peintres flamands ou italiens de la Renaissance travaillaient en ateliers, entourés d’assistants et d’apprentis. De même les stars de l’art contemporain, de Jeff Koons à Anselm Kiefer en passant par Jean-Michel Othoniel et tant d’autres. Leur signature apparaît pourtant seule sur les cartels, et leurs œuvres ne sont pas présentées ou considérées comme collaboratives.
Je me suis souvent étonné de voir, dans plus d’une exposition, évacuer les noms des scénaristes, comme si les dessinateurs avaient travaillé seuls. Mais si cette élimination me paraissait et me paraît toujours incorrecte, c’est parce que les scénaristes en question sont dûment crédités, en couverture et à l’intérieur des ouvrages, comme co-auteurs. La revendication portée par Sylvain Lesage, elle, me paraît abusive. Ou alors il faut changer les pratiques qui ont cours dans l’ensemble des musées du monde.