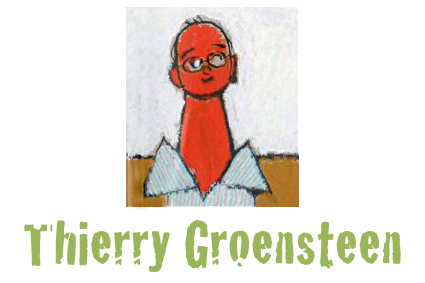Ami lecteur, amie lectrice, si vous êtes réfractaire à la théorie, épargnez-vous la lecture de ce billet et attendez le prochain.
J’aimerais, en effet, en dehors de toute actualité, revenir quelques instants sur deux notions introduites naguère par Benoît Peeters dans le livre par lequel il contribua à l’élaboration d’une théorie de la bande dessinée d’inspiration sémiotique, le récit et le tableau. Notions posées comme en opposition l’une à l’autre, et qui avaient d’abord exercé sur moi une séduction immédiate, notamment en raison de la simplicité de ces deux vocables empruntés au lexique commun.
Benoît les introduisait au moment de proposer sa typologie de la mise en page, qui, on s’en souvient, comporte quatre cas, selon qu’elle peut être décrite comme relevant d’une utilisation rhétorique, régulière, décorative ou productive. Ainsi que je le résumais dans Système de la bande dessinée (édition de 1999, p. 116), cette typologie découlait « de l’opposition initiale entre le récit, “qui, englobant l’image dans une continuité, tend à nous faire glisser sur elle”, et le tableau, “qui, l’isolant, permet qu’on se fixe sur elle”. Les quatre conceptions de la mise en page proposées se définissaient par le fait que récit et tableau étaient ou non indépendants, et suivant que l’un dominait l’autre. »
Pourtant, je m’en désolidarisais au motif que ces deux instances me paraissaient « trop générales pour permettre une analyse fine des enjeux qui concernent l’opération de la mise en page. » Je parlais cependant d’un « effet tableau », s’agissant des planches dont la configuration globale ne pouvait manquer de frapper le lecteur avant même qu’il n’entame sa lecture case à case.
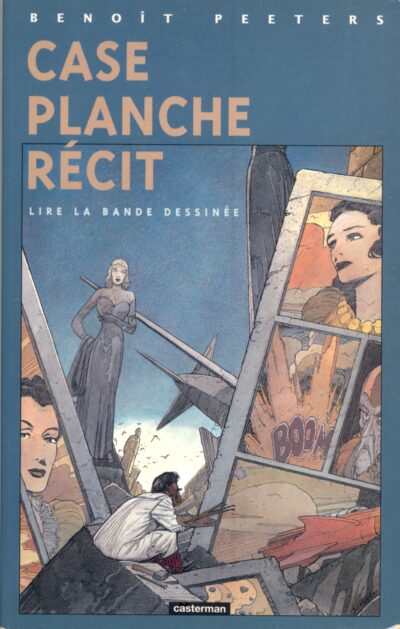
Benoît inscrivait son propos dans la continuité de l’opposition posée antérieurement par Pierre Fresnault-Deruelle entre le linéaire et le tabulaire. Mais, en relisant récemment le chapitre concerné, j’ai été frappé par le fait que ces notions de récit et tableau étaient somme toute assez peu définies, à la fois en elles-mêmes et dans leur interaction. Benoît en parlait comme de « deux dimensions contradictoires, la première appartenant plutôt à l’ordre du temps, la seconde à celui de l’espace ». Il ne disait rien de plus sur ce qu’il convenait exactement d’entendre par tableau. Et dans les exemples de pages analysées ensuite, tableau et récit n’étaient reconvoqués qu’à propos de la planche de Fred (tirée de Simbabbad de Batbad) dans laquelle Philémon escalade un chien géant, pour observer que Fred introduisait du jeu entre ces deux dimensions.
Le temps et l’espace sont des catégories qui, chez Benoît comme chez moi, renvoient aux opérations du découpage, d’un côté, et de la mise en page, de l’autre – et le chapitre d’où sont extraites les lignes que je viens de citer, qui, dans sa version initiale, s’était d’abord appelé « les aventures de la page », a désormais pour titre (je me réfère à l’édition de 1998 de Case planche récit), précisément, « Découpage et mise en pages ». (Remarquons-le : Découpage au singulier, mise en pages au pluriel, comme s’il y avait quatre utilisations possibles de la page mais un seul modèle de découpage.) Et si le récit « englobe l’image dans une continuité », ne peut-on dire de la mise en page qu’elle « englobe l’image dans une totalité », celle du multicadre ?
Le plus surprenant est ce que Benoît écrivait ensuite : « Cette double temporalité marque une différence par rapport au cinéma, art fondamentalement linéaire. Le cinéma pourrait en effet être dit immédiatement narratif : dans un film, chaque nouveau plan a, en dehors même de son contenu, un caractère inattendu ; on ne pouvait jamais le pré-voir. »
Ce qu’il y a de surprenant dans ces lignes, c’est le fait de souligner une différence essentielle, quasi ontologique, entre la bande dessinée et le cinéma, alors même que les notions de récit et de tableau, Benoît les empruntait à un article de Raoul Ruiz et Jean-Louis Schefer paru en 1980 dans Ça Cinéma (la référence est donnée en note), qui concernait exclusivement le 7e art. On sait que Peeters et Ruiz ont été proches, qu’ils collaborèrent à l’écriture du film la Chouette aveugle et que le premier allait cosigner, avec Guy Scarpetta, un essai intitulé Raoul Ruiz, le magicien (les Impressions nouvelles, 2015). Il était donc on ne peut plus familier de sa pensée.
Mais il ne cite pas précisément ce que Schefer et Ruiz disaient dans leur article. Voici le fragment concerné : « Disons que dans un film il y aurait l’aspect tableau et l’aspect récit, donc dans le cinéma il y a constamment un tableau, un tableau qui est à l’intérieur du cadre, qui n’est pas le cadre, qui est quelque part à l’intérieur et à l’extérieur, jamais dans le cadre précisément et qui se définit par les rapports des objets qui sont à l’intérieur – et ces objets sont des récits en puissance. (…) Je me demandais quel est le rapport entre [le] récit, récit comme jeu de volontés, et le tableau, tel qu’on fait des choix parmi les éléments de ce tableau, pour que le spectateur puisse jouer son propre récit. » (p. 70) Et encore : « Dans un film, l’aspect tableau est constitué par l’époque, par tels décors ou comédiens, et le récit, évidemment, c’est ce qui s’est passé » (p. 78)
Il faut bien avouer que la poétique ruizienne n’est pas des plus limpides et que ce tableau bien difficile à situer ne semble pas loin de se confondre avec la diégèse elle-même, ou du moins le répertoire de motifs qu’elle propose.
En tout cas, Benoît avait déjà repris à la même source les notions de récit et de tableau dans un de ses ouvrages antérieurs, un petit essai sur le cinéma intitulé Hitchcock, le travail du film (Les Impressions nouvelles, 1993 ; voir pages 3ss). J’en retiens ces quelques lignes qui, bien qu’essentielles à mon sens, figurent dans une note en fin d’ouvrage : « Il importe évidemment de ne pas confondre le “tableau” avec l’image. Le cinéma étant un art à paramètres multiples, le tableau met en jeu aussi bien les nombreux éléments de la bande-son que les composants visuels. Dans cette acception, le “récit” n’est du reste non plus strictement narratif ; ce peut être simplement quelque chose comme la ligne générale du film. »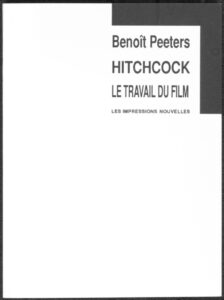
N’est-il pas fascinant d’observer comment ce couple de notions s’est révélé intersémiotique et quelque peu polysémique, au point de pouvoir migrer, sous la même plume, d’une théorie du cinéma (art « fondamentalement linéaire », et qui combine image et son) vers une théorie de la bande dessinée ? Mais peut-être était-il finalement plus à l’aise appliqué à ce domaine d’adoption, et s’y révélait-il plus pertinent. Reste qu’il mériterait sans doute d’être élaboré avec plus de précisions – mais ce n’est pas ici le lieu d’engager ce travail.